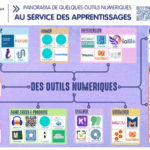« Ne serait-ce pas parce que les performances en calcul sont aujourd’hui extrêmement dégradées dès le CM2 que, 4-5 ans plus tard, chez les élèves d’âge PISA, les performances en mathématiques ne sont pas ce qu’elles devraient être ? » Rémi Brissiaud, chercheur à Paris 8, attire l’attention sur l’enseignement des maths et particulièrement l’usage de la file numérique. Pour lui, « pour espérer un futur redressement, il n’y a pas d’autre solution que de revenir aux causes de l’effondrement qui s’est produit en CM2 ». Autrement dit changer en profondeur l’enseignement des maths au primaire.
Les résultats de l’enquête PISA 2012 viennent de sortir : ils sont très mauvais pour les élèves français. Comme toujours, les causes d’un tel phénomène sont vraisemblablement plurielles mais il y a une cause qui commence à être bien documentée et sur laquelle il faut revenir : les performances en calcul des élèves de CM2 français étaient bonnes en 1987 mais elles se sont effondrées entre 1987 et 1999. L’étude de la DEPP qui le prouve, menée par Thierry Rocher, a été publiée en décembre 2008 . Elle était disponible bien avant, mais elle est « restée dans les cartons » : Xavier Darcos était alors ministre et cela n’entrait dans son plan de communication que les enfants aient été performants en 1987, près de 20 ans après Mai 68. Depuis 1999, les performances stagnent à un très bas niveau. Parler d’ « effondrement » ne relève en rien d’une rhétorique catastrophiste : entre 1987 et 1999, la moyenne des performances des élèves de CM2 a baissé de 66% de l’écart-type initial ! Or, il est légitime de s’inquiéter à partir de 20% et, dans d’autres enquêtes du même type, une année d’apprentissage correspond à environ 50%. Ainsi, c’est plus d’une année d’apprentissage que les élèves de CM2 ont perdu entre 1987 et 1999.
Les élèves de 3e et de 2nde, quand ils passent les épreuves PISA, ont un passé scolaire. Les années1999 et 2003, dates des premières passations PISA, correspondent à l’arrivée en 3e et 2nde des premières générations d’élèves de CM2 dont les performances en calcul sont dégradées. Cela est cohérent avec le fait qu’à l’époque, les observateurs ont été surpris du rang très moyen de la France en mathématiques, un rang sans rapport avec l’excellence de la recherche en mathématiques dans notre pays : peut-être la dégradation des performances en calcul dès le CM2 avait-elle déjà eu un certain effet. En revanche, l’OCDE parle de « chute des résultats » entre 2003 et 2006. Il est normal que la baisse soit particulièrement marquée pendant ces années là : au début, quand les professeurs de collèges voient arriver des élèves aux performances dégradées, leur pratique pédagogique a un effet compensatoire parce qu’ils essaient que ces performances se rapprochent de la norme qui était celle des générations précédentes. Mais progressivement, ils oublient cette norme et, finalement, ils tolèrent un taux d’échecs beaucoup plus important. Et les résultats d’aujourd’hui ? La dégradation se poursuit, mais plus lentement : l’essentiel du choc s’est situé entre 2003 et 2006. Sur l’ensemble de la période, le nombre d’élèves très performants est resté à peu près stable alors que celui des élèves en difficulté a considérablement augmenté. Le rapport note que : « le système s’est dégradé principalement par le bas entre 2003 et 2012 ».
L’ensemble de ces données est compatible avec l’hypothèse qu’en grand partie, la baisse des performances observée par PISA est le contre-coup de l’effondrement des performances en calcul observé auparavant en CM2. Cela ne veut évidemment pas dire que le travail en collège ne devrait pas être questionné, il s’agit juste d’affirmer que le niveau de performances en 3e et 2nde ne peut pas être sans lien avec celui observé au CM2. Or, l’effondrement des performances en calcul en CM2 a deux caractéristiques tout à fait étonnantes[i], si étonnantes que la plupart des commentateurs hésitent à en parler, comme s’ils en étaient dérangés :
1°) Les élèves de 1987, ceux qui calculaient bien mieux qu’aujourd’hui, n’avaient eu aucun apprentissage numérique avant novembre au CP : ni à l’école maternelle, ni au début du CP. En effet, ces élèves avaient fréquenté une école maternelle très influencée par les travaux de Jean Piaget et les pédagogues d’alors pensaient qu’enseigner les nombres à l’école maternelle ne pouvait conduire qu’à une sorte de dressage. Aujourd’hui les élèves apprennent à compter à l’école dès la petite section, à 3 – 4 ans. On est donc face à un phénomène peu banal : en commençant leurs apprentissages numériques bien plus tardivement qu’aujourd’hui, les élèves de 1987 calculaient bien mieux qu’aujourd’hui.
2°) L’effondrement se produit immédiatement après 1986, date d’une circulaire ministérielle qui est le premier jalon d’un basculement dans les choix didactiques de l’école française : à partir de cette date, il sera préconisé d’enseigner le calcul en adoptant une progression qui était vouée aux gémonies dans les années précédentes (nous la décrivons plus loin). Là encore, on est face à un phénomène peu banal qui consiste, pour un métier, à changer à 180° ses « bonnes pratiques », du moins leurs préconisations officielles. Qu’il s’agisse d’enseignants mettant en œuvre les programmes de 2002 ou d’autres mettant en œuvre ceux de 2008, dans les deux cas, ces enseignants auraient été considérés avec effarement par l’élite des pédagogues du milieu du siècle dernier. De ce point de vue, les programmes de 2008 se situent dans la stricte continuité de ceux de 2002.
Levons tout de suite une objection : à partir d’une autre évaluation de la DEPP publiée en octobre dernier[ii], portant sur les performances des élèves en début de CP, certains ont cru pouvoir affirmer que les programmes de 2008 prépareraient mieux les élèves de maternelle que les précédents. Or, j’ai rencontré les chercheurs qui ont mené cette étude, nous avons examiné ensemble chacune des épreuves qu’ils avaient proposées une première fois en 1997 et une seconde fois en 2011 : il apparaît clairement que, depuis 2008, dans le contexte pédagogique actuel, les élèves sont conditionnés à les réussir. En fait, il y a une seule épreuve pour laquelle ce n’est pas le cas et elle n’est pas mieux réussie que si les enfants répondaient au hasard.
La question suivante reste donc d’actualité : ne serait-ce pas parce que les performances en calcul sont aujourd’hui extrêmement dégradées dès le CM2 que, 4-5 ans plus tard, chez les élèves d’âge PISA, les performances en mathématiques ne sont pas ce qu’elles devraient être ? Pour espérer un futur redressement, il n’y a pas d’autre solution que de revenir aux causes de l’effondrement qui s’est produit en CM2 entre 1987 et 1999. Un tel diagnostic est incontournable. Il est d’autant plus important de s’y livrer qu’il est porteur d’espoir : nous verrons en effet qu’il ne serait pas si compliqué de rédiger de nouveaux programmes, acceptables par tous, qui seraient appliqués par tous et qui amorceraient un redressement salutaire.
Ainsi, à ce jour, une seule cause de l’effondrement a été avancée, cohérente avec le fait que celui-ci se produit vers la fin des années 80 et durant les années 90 : il faut incriminer le changement de culture pédagogique de notre école suite à de larges emprunts faits à celle des États-Unis, à partir de 1986. Pourquoi Mathieu n’apprend-t-il plus à calculer ? Parce qu’à l’école, il s’est mis à apprendre à compter comme Matthew. Dans un petit ouvrage publié en février 2013, « Apprendre à calculer à l’école — les pièges à éviter en contexte francophone », j’ai montré comment l’histoire des discours et des pratiques pédagogiques ainsi que tout un ensemble de recherches issues de la psychologie des apprentissages numériques, de la psychologie clinique et de la psychologie interculturelle, permettent de comprendre l’effet catastrophique de ce changement de culture pédagogique.
On peut présenter succinctement ce qu’était la culture pédagogique de l’école française vers le milieu du siècle dernier à partir d’un extrait d’un rapport publié en 1955 sous la direction de Gaston Mialaret[iii], l’un des fondateurs des Sciences de l’Éducation en France, ex président du GFEN et, plus généralement, très engagé dans le mouvement de l’Éducation Nouvelle. Ce rapport fait suite à ce que Gaston Mialaret présente comme une « réunion d’experts chargés d’étudier et de résumer les principes pédagogiques fondamentaux de l’initiation au calcul » (page 3), réunion qui s’est tenue sous l’égide de l’UNESCO. Soyons encore plus précis : la citation qui suit est d’Henri Canac, sous-directeur de l’ENS de Saint-Cloud. On retrouve en effet le même extrait dans plusieurs de ses écrits précédents. Il s’exprime ainsi à propos des élèves dont on dit aujourd’hui qu’ils sont fragiles, ceux qui mettent particulièrement en difficulté notre école : «Dans de nombreux cours élémentaires, ou même cours moyens, on trouve souvent de grands benêts qui comptent sur leurs doigts (en cachette lorsque M. l’Inspecteur est là) ou qui, sommés de résoudre une simple opération, comme 8 + 5, se récitent intérieurement à eux-mêmes : 8, 9, 10, 11, 12, 13 en évoquant des doigts imaginaires. Au vrai, avec ces élèves « mal débutés », comme on dit, il n’est qu’un moyen d’en sortir, qui est de leur faire apprendre par cœur les tables d’addition. Comme il a appris jadis la suite naturelle des nombres, le grand benêt de 8 ou 9 ans, si on l’assujettit tous les jours à répondre à des interrogations rapides sur la table d’addition ( 8 et 5 ? 4 et 3 ? 7 et 9 ? 8 et 4 ? …) finira par proférer sans hésitation les groupes de mots : huit et cinq, treize ; quatre et trois, sept ; etc… et se libèrera ainsi de la servitude des bûchettes, des barres ou des doigts. Oui, mais ce sera passer d’une routine à une autre. Or, il y a beaucoup mieux à faire… » (les points de suspensions seront complétés plus loin dans ce texte).
Considérons maintenant une leçon de CP dont l’usage, qui s’est généralisé à partir de 1986, est très vraisemblablement l’une des causes majeures de l’effondrement des performances en calcul. Le fichier dont est extraite la leçon ci-dessous date de 1991 et la leçon se situe en décembre.

Ce type de séquence ne figurait dans aucun manuel ou fichier de CP français avant 1986 ; aujourd’hui, l’usage de la file numérotée qui y est décrit figure dans presque tous les manuels, fichiers, logiciels, etc. C’est celui qui est véhiculé par la Kahn Academy, un cours en ligne états-unien (MOOC), récemment traduit en français et dont la parution a eu beaucoup d’échos dans les médias. La préconisation d’un comptage sur les mains est également présente dans diverses aides pédagogiques mais elle est moins fréquente ; en fait, ce dernier fait a peu d’importance : lorsqu’un enfant a appris à trouver le résultat d’une addition à l’aide d’une file numérotée et lorsqu’il n’a plus cet outil à disposition, il le remplace par ses doigts.
Dans une très large majorité de CP français, aujourd’hui, une file numérotée est affichée dans la classe et les enfants l’utilisent comme c’est indiqué dans la leçon précédente pour trouver le résultat d’une addition. Cet usage de la file numérotée faisait même partie du contenu des programmes de 2002. Ainsi, l’un des objectifs du cycle 2, était rédigé ainsi : « Déterminer, par addition ou soustraction, la position atteinte sur une ligne graduée après un déplacement en avant ou en arrière ». Et concernant les programmes de 2008 ? Ils ne contiennent aucune mise en garde contre un tel enseignement. Pire : comme depuis 2008, les élèves de maternelle devraient utiliser une telle file numérotée pour apprendre à écrire les nombres jusqu’à 30, son usage est encore plus généralisé qu’avant 2008. De façon institutionnelle, donc, l’école française a fait un choix didactique qui, vers le milieu du siècle dernier, était considéré comme le pire qui puisse être envisagé, puisqu’on l’accusait de « mal débuter les élèves ». On peut donc bien parler d’un virage à 180° dans les choix didactiques retenus.
Avant de répondre à cette question, il convient d’expliquer pourquoi la suite des écritures chiffrées de la leçon précédente est appelée ici une « file numérotée ». En effet, dans un texte mis récemment en ligne sur le Café Pédagogique, Joël Briand, Marie-Lise Peltier et Danielle Vergnes[iv] parlent, eux, de « file numérique ». Pourquoi ces appellations différentes ? Ces professeurs de mathématiques sont parmi les principaux défenseurs de l’usage en classe d’une file contenant la suite des écritures chiffrées et, évidemment, ils s’expriment de manière optimiste en considérant que celle-ci est traitée par les enfants comme une file qui serait authentiquement numérique, c’est-à-dire une suite d’écritures chiffrées renvoyant chacune aux différentes pluralités que sont les nombres. Ce n’est malheureusement pas le cas. Ces mathématiciens admettent d’ailleurs que « à l’issue de la maternelle 13 est plutôt conçu comme une entité globale ». En fait, 13, comme les autres écritures chiffrées, est d’abord considéré comme un numéro ; c’est le nom de la case correspondante, la case 13.
Un numéro renvoie à une seule entité alors qu’un nombre, lui, renvoie à une pluralité et il est clair qu’un numéro ne véhicule pas nécessairement l’idée du nombre correspondant : lorsqu’on a la chambre d’hôtel « 407 », par exemple, il n’y a généralement pas autant de chambres dans l’hôtel parce que le premier chiffre renvoie à l’étage. Même dans les contextes où tous les numéros sont présents dans l’ordre, comme c’est le cas du contexte de la file numérotée, on utilise le plus souvent les numéros sans évoquer les nombres correspondants. Pour comprendre le fonctionnement cognitif d’un adulte dans un tel contexte, il suffit de s’imaginer un théâtre dont les sièges sont numérotés avec des lettres plutôt qu’avec des chiffres : sachant que « j’ai le siège R », par exemple, je n’ai nullement besoin de penser à la pluralité correspondant à R pour retrouver mon siège. Nous sommes d’ailleurs complètement incapables de répondre de manière précise à la question : « C’est combien R ? » Nous en sommes incapables et cela ne nous empêche pas de retrouver notre siège.
Les nombres, eux, renvoient à des pluralités : pour dire ce qu’est « deux », je n’ai pas d’autre choix que de produire une collection correspondante (une « collection-témoin ») ou d’expliciter une décomposition de ce nombre : 2 = 1 + 1 ou « deux, c’est un et encore un ». Idem avec « trois » : 3 = 1 + 1 + 1 ou 3 = 2 + 1, etc.
C’est à ce niveau qu’une sorte de « piège pédagogique » se noue : la leçon précédente, celle des images de Karim, permet aux élèves de répondre correctement en raisonnant sur des numéros et non sur des nombres. On s’en rend bien compte en imaginant que dans cette leçon, la file est numérotée avec les lettres de l’alphabet plutôt qu’avec les écritures chiffrées et que la tâche proposée à l’élève consiste à compléter R + C = ?, par exemple. Même des élèves très faibles peuvent se comporter comme c’est indiqué dans la leçon : l’enfant commence par mettre le doigt sur la case R (c’est celle de départ), puis il dit A au-dessus de la case suivante (la case S), il dit B au-dessus de la suivante (la case T) et enfin C au-dessus de la suivante : c’est la case U, celle d’arrivée. Et l’élève complète l’égalité avec le numéro de la case d’arrivée, comme cela lui a été indiqué : R + C = U. Cette égalité ressemble à une addition. Au plan formel, l’addition correspondante est d’ailleurs juste et elle sera considérée comme telle par l’enseignant qui devra donner une bonne appréciation. Sauf que pour réussir, il n’est absolument pas nécessaire d’évoquer mentalement les pluralités correspondant à R et U. Dans un tel contexte, les élèves donnent les bonnes réponses en utilisant la « recette » qu’on leur a montrée (repérer la case de départ, etc.) alors que dans leur tête, ils ne mettent pas en relation des pluralités, ils ne calculent pas. À terme, l’enseignant se rend compte que de nombreux élèves ne progressent pas comme ils devraient : comme ils ne mettent pas en relation des pluralités, ils ne mémorisent pas les relations correspondantes et, « avec ces élèves « mal débutés » …/… il n’est qu’un moyen d’en sortir, qui est de leur faire apprendre par cœur les tables d’addition …/… Or, il y a beaucoup mieux à faire… ».
L’intelligence des nombres réside dans leur mise en relation et, donc, dans le calcul alors que le comptage-numérotage n’assure d’aucune façon cette intelligence. Et sans intelligence des nombres, il n’y a pas de mémorisation des relations numériques possible autrement que par le rabâchage. Et encore, ça ne marche pas toujours parce que l’oubli est important : toutes les études sur la difficulté en mathématiques montrent que le profil type de l’élève concerné est celui d’un enfant âgé qui n’a toujours pas mémorisé les additions élémentaires alors qu’on s’est évertué à ce qu’il le fasse, y compris au moyen du rabâchage.
C’est la raison pour laquelle les pédagogues de l’Éducation Nouvelle, vers le milieu du siècle dernier, préconisaient de progresser beaucoup plus graduellement. La méthode correspondante était présentées en 1955 par Henri Canac comme une «?méthode nouvelle?» qui «?forme à (son) sens, une des meilleures conquêtes de la pratique pédagogique au cours du dernier quart de siècle.?» Elle consistait à découvrir les nombres dans l’ordre afin de : «? construire (définir, poser), le nouveau nombre par adjonction de l’unité au nombre précédent, puis à étudier ses diverses décompositions en nombres moins élevés que lui. »
Ainsi, concernant les 10 premiers nombres, l’accent était mis sur l’appropriation de leurs décompositions. Et concernant la mémorisation des résultats d’additions dont le résultat dépasse 10 ? Dès 1928, dans un rapport des inspecteurs généraux Marijon et Leconte, la recommandation était très claire : « Il convient, selon nous, d’arriver très vite à la formation, par voie purement mentale, de 8 + 7 = 15, au moyen de 8 + 2 = 10, 10 + 5 = 15, étant entendu que ces exercices auraient été précédés de nombreuses réalisations manuelles et visuelles ?». On notera que l’usage d’une telle stratégie n’est pas accessible à un élève qui ne s’est pas approprié la décomposition : 7 = 2 + 5. De façon générale, il n’y pas d’usage de stratégies de décomposition-recomposition possibles pour obtenir le résultat d’une addition dont le résultat dépasse 10, sans une bonne connaissance des décompositions des dix premiers nombres. À aucun moment, l’usage d’une file numérotée n’était considéré comme une propédeutique aux stratégies de décomposition-recomposition : il n’était tout simplement pas envisagé.
Revenons à PISA : pour certains des pays participant à l’enquête, on dispose de données concernant les performances en calcul des enfants lorsqu’ils étaient plus jeunes. Les différences de performances apparaissent tôt dans la scolarité. Ainsi, en Chine (Taïwan) les résultats d’additions élémentaires sont mémorisés dans 86% des cas en fin de 1ère année d’école alors qu’ils ne le sont que dans 26% des cas aux États-Unis (Geary et al)[v]. Il faut insister : en psychologie expérimentale, de telles différences sont exceptionnelles. Ainsi, en fin de 1ère année d’école, la mémorisation n’a pratiquement pas commencé chez les enfants états-uniens quand elle est presque achevée chez les enfants chinois. Que font les élèves états-uniens pour donner le résultat d’une addition ? Ils comptent, évidemment, et ceci dans 64% des cas (4% des cas en Chine). Mais comment s’en étonner puisque c’est ce qu’on leur a appris à faire ! En 1982, un psychologue japonais[vi] découvrant l’emploi que font les pédagogues états-uniens d’une file numérotée, faisait part de sa surprise : jamais les pédagogues japonais ne s’y prennent ainsi, ils favorisent systématiquement l’usage de stratégies de décomposition-recomposition. Les raisons de la différence de performances entre enfants états-uniens et enfants asiatiques sont nombreuses (façon de dire les nombres après dix, notamment) mais il y en a une qui joue nécessairement un rôle majeur : lorsqu’ils comptent, les élèves états-uniens font ce que leurs maîtres leur ont demandé de faire, ce qu’ils ont valorisé. La pédagogie des États-Unis se révèle extrêmement efficace pour enfermer les enfants dans le comptage et les empêcher de mémoriser les résultats d’additions élémentaires. La France, du temps où ses maîtres mettaient d’emblée l’accent sur les décompositions des nombres et le calcul, c’est-à-dire du temps où sa culture pédagogique était proche de celle des pays asiatiques, surpassait largement les États-Unis. Aujourd’hui ce n’est plus le cas.
L’analyse précédente est loin d’être récente (Brissiaud, 1989, 2007 ; Fischer, 1992)[vii] et, depuis 2 ans environ, j’essaie d’en diffuser les éléments essentiels le plus largement possible. La raison en est simple : depuis la publication de l’étude de la DEPP, en décembre 2008, on connaît l’ampleur de l’effondrement des performances en calcul des élèves de CM2. Dans chaque génération d’élèves, le basculement pédagogique décrit ici est vraisemblablement à l’origine de parcours d’échec en mathématiques se comptant par dizaines de milliers. Pour ces jeunes et pour leur famille, c’est un énorme gâchis humain. Pour le pays, cela représente un coût économique colossal : remboursement des prises en charge d’orthophonistes, défiscalisation des cours particuliers, redoublements, conséquences économiques et sociales à long terme. Pour les professeurs également, c’est beaucoup de déception et de souffrance.
Ainsi, cette analyse a été présentée début 2013 au séminaire des archives Piaget à Genève, puis au séminaire national de didactique des mathématiques à Paris et enfin au séminaire annuel de didactique des mathématiques de l’IFÉ de Lyon, sans qu’aucune objection majeure ne lui ait été adressée. Des personnalités aux profils aussi différents que Michel Fayol, chercheur en psychologie bien connu des enseignants, Pierre Barrouillet, directeur des Archives Jean Piaget, Michèle Artigue, didacticienne des mathématiques qui vient de recevoir la médaille Félix Klein ou Pierre Arnoux, un des grands mathématiciens français, par exemple, se sont dites convaincues par cette analyse. Chacune y apportant son commentaire, évidemment. Michèle Artigue, par exemple, insiste sur le fait qu’il est important de développer un rapport ludique au calcul et elle a raison de le faire : les leçons successives sur le nombre 4, puis le nombre 5, puis le nombre 6… comme elles se faisaient souvent au siècle dernier, toutes structurées de la même manière, engendraient beaucoup d’ennui et il ne conviendrait guère d’y revenir. Faisons confiance à la créativité pédagogique : il est possible d’aborder les nombres progressivement en s’y prenant de façon moins ennuyeuse, tout en conservant l’objectif de favoriser d’emblée le calcul.
Bref, le dossier est épais, bien argumenté et il bénéficie d’appuis scientifiques de qualité : les programmes tels qu’ils sont aujourd’hui, parce qu’ils retardent l’entrée dans le calcul, ne sauraient être conservés tels quels. C’est peu dire qu’en prenant connaissance d’un récent rapport de l’inspection générale sur le suivi des programmes de 2008[viii], la surprise fut grande : l’inspection générale valide les programmes de 2008 ! Pire : il est fortement suggéré que si les élèves n’apprennent pas à calculer, c’est la faute aux professeurs des écoles.
En effet, dans leur rapport, les IG commencent par extraire des programmes une sentence : « L’acquisition des mécanismes en mathématiques est toujours associée à une intelligence de leur situation ». Des propos aussi généraux, sans davantage de précisions sur les tâches concernées, sont susceptible de provoquer des réticences ou des réactions négatives. Bien sûr qu’un professeur essaiera dans la mesure de son possible d’associer l’acquisition des mécanismes et la compréhension. La question qui se pose à lui n’est pas celle du but à se fixer mais bien celle des moyens permettant d’atteindre ce but. Est-ce la raison pour laquelle cette phrase a été parfois mal reçue par les professeurs des écoles ? Toujours est-il que les IG commentent ainsi les propos des professeurs : La question du lien entre « acquisition d’automatismes » et « intelligence de leur signification » n’est pas toujours comprise. La phrase où sont liées ces deux notions est jugée quelquefois « totalement hermétique » par certains enseignants ; pour d’autres, cette même phrase est indiquée comme ayant été « une pierre d’achoppement » à l’arrivée des programmes, au sujet de laquelle il a fallu de « grands efforts d’explication ». Ce qui ne manque pas d’interroger sur la nature de l’enseignement dispensé, sur les voies choisies pour que les élèves acquièrent les automatismes visés, et sur un possible déficit de formation des enseignants quant au rôle de la mémoire dans les apprentissages.
En s’interrogeant sur « les voies choisies (par les professeurs) pour que les élèves acquièrent les automatismes visés », les IG les soupçonnent en fait d’être insuffisamment attentifs « à l’intelligence des situations correspondantes » et, donc, de se préoccuper seulement du plus facile : exercer de manière répétitive les procédures à automatiser et faire rabâcher par les élèves ce qu’il convient de mémoriser. Ce reproche est humiliant.
En effet, nous avons vu que les programmes de 2008, comme ceux de 2002, font des recommandations conduisant à « mal débuter » les élèves. Concernant les résultats d’additions élémentaires, certains pédagogues, bien évidemment, décident d’adopter le « seul moyen de s’en sortir » évoqué par Henri Canac, à savoir l’apprentissage par cœur des tables d’additions. Les IG, sur le mode du reproche et de la condescendance, rappellent à ces pédagogues qu’ils ne doivent pas oublier de mettre en avant l’« intelligence de la situation correspondante ». Il faut le dire clairement : comme les programmes interdisent de mettre en œuvre les pratiques pédagogiques auxquelles pense Henri Canac quand il dit qu’ « il y aurait mieux à faire… », les professeurs des écoles n’ont aucune chance de s’en sortir. On leur recommande une façon de faire la classe qui les envoie dans le mur et lorsqu’ils appuient sur le frein, on leur dit que ce n’est pas non plus la bonne façon de procéder. Ils sont face à des injonctions contradictoires qui, typiquement, conduisent soit à la révolte, soit au repli sur soi. Le statu quo n’est décidément pas possible : il serait source de tensions insupportables.
Ne pas imposer une progressivité plutôt qu’une autre, dans les limites du raisonnable
Après tout ce qui vient d’être dit, cette prise de position peut surprendre. Et pourtant, les arguments en faveur d’un tel choix sont nombreux.
En premier lieu : comment pourrait-on se permettre, après avoir préconisé pendant 25 ans aux professeurs des écoles d’afficher une file numérotée dans leur classe, de leur interdire aujourd’hui de le faire ? Ce serait le summum de l’absence de respect de leur compétence professionnelle. Quelqu’un qui, comme moi, pense que ce serait effectivement bien qu’ils s’en passent n’a pas d’autre choix que de continuer à faire des recherches, à écrire des synthèses des résultats disponibles, à faire des conférences, à débattre avec les autres chercheurs et les enseignants afin de présenter les nombreux arguments en faveur d’un autre choix didactique.
En second lieu, la réalité du côté des formateurs est aujourd’hui la suivante : la formation initiale et continue des enseignants est pour l’essentiel assurée par des professeurs de mathématiques qui, dans leur très grande majorité, ont joué un rôle déterminant dans le changement de culture pédagogique de la fin des années 80. Pour certains, c’est le discours qu’ils ont tenu pendant toute leur carrière qui se voit ainsi questionné. Il est évident qu’ils ne peuvent pas considérer avec sérénité qu’un autre choix est préférable ; dans un premier temps au moins, ce serait un grand progrès si l’institution Éducation Nationale les amenaient à envisager une pluralité de choix dans leurs actions de formation. On peut d’ailleurs se demander si ce qui vient d’être dit concernant les professeurs de mathématiques ne vaudrait pas pour les inspecteurs généraux de mathématiques.
Enfin, cela permettrait aux enseignants qui le souhaitent, de retisser des liens avec la culture pédagogique qui était celle de notre école vers le milieu du siècle dernier, sous l’influence de l’Éducation Nouvelle notamment. En fait, certains professeurs le font déjà aujourd’hui : ils consacrent le début du CP à s’assurer que leurs élèves ont une connaissance approfondie des 5 premiers nombres, c’est-à-dire qu’ils savent résoudre des problèmes mettant en jeu des décompositions de ces nombres. Par exemple : derrière un écran, la poupée Amélie a 5 bonbons et la poupée Julie en a 3 ; combien faut-il donner de bonbons à Julie pour qu’elles aient le même nombre ? La validation se fait en ôtant l’écran et en réalisant l’action : de façon générale, à ce niveau de la scolarité, il est essentiel que les enfants découvrent que l’enjeu de l’activité mathématique est d’anticiper le résultat d’actions qui affectent la taille des collections : ajout, retrait, partage… Après s’être assurés que les élèves maîtrisent les 5 premiers nombres, ces enseignants, dans un deuxième temps, visent à ce que leurs élèves s’approprient les décompositions des 10 premiers nombres, puis des 20 premiers nombres, etc. Aujourd’hui, l’institution met souvent en difficulté les enseignants qui adoptent cette progressivité : comme les enfants sont censé avoir découvert les nombres jusqu’à 30 en GS de maternelle (confusion entre nombres et numéros !), il leur est reproché de s’attarder sur les 5 premiers nombres en début d’année et de ne pas prendre en compte ce que sauraient les enfants. Dans beaucoup de départements, des évaluations départementales sont élaborées en considérant que cela va de soi qu’au CP, il faut apprendre très tôt dans l’année à compter jusqu’à 50. Les enseignants qui pensent autrement sont contraints soit de ne pas proposer les épreuves correspondante à leurs élèves, soit de les leur proposer en sachant qu’elles vont les mettre en échec. Ainsi, ne pas imposer une progressivité plutôt qu’une autre, conduirait à laisser travailler les enseignants qui souhaitent privilégier d’emblée le calcul plutôt que le comptage. C’est une liberté essentielle, susceptible d’amorcer le redressement.
Définir des objectifs de fin de cycle compatibles avec les différentes progressivités possibles
Bien entendu, des objectifs de fin de cycles « raisonnables », qui s’imposeront à tous, devront être définis. Mais le choix de la progressivité des apprentissages conduisant à atteindre ces objectifs doit rester l’apanage des conseils de cycles. Les différentes progressivités possibles sont connues des spécialistes du domaine et il ne devrait pas être trop difficile de définir des objectifs de fin de cycle compatibles avec ces différentes progressivités. Le fait que le CE2 fasse aujourd’hui partie du cycle 2 et que la 6e fasse partie du cycle 3, va faciliter l’accord entre les divers points de vue et il est même imaginable, comme Antoine Prost aimerait que ce soit le cas, de définir un ensemble d’exercice devant être réussis à la fin de ces cycles, quelle que soit la progressivité adoptée.
C’est avec les objectifs de fin de maternelle qu’un accord risque d’être le plus difficile à trouver. En effet, lorsqu’on adopte une progressivité « à la Canac », les données expérimentales disponibles montrent qu’il est raisonnable de viser les compétences définies plus haut dans ce texte, celles dont on s’assurera qu’elles sont effectivement présentes au début du CP : viser à ce que les enfants maîtrisent de façon approfondie les 5 premiers nombres. Les élèves de maternelle peuvent aussi avoir rencontré les nombres jusqu’à 10 à l’aide des décompositions de ces nombres qui utilisent le repère cinq : 6, c’est 5 et encore 1 ; 7, c’est 5 et encore 2 ; etc. Viser plus haut ne peut qu’exclure un grand nombre d’élèves a priori, notamment parmi ceux qui sont nés en fin d’année. Rien ne peut donc être exigé au-delà. Il faut donc que les défenseurs d’une progressivité basée sur l’usage d’une file numérotée, acceptent que l’apprentissage du comptage jusqu’à 30 ne figure pas dans les programmes. Sinon, entre un enseignant de GS qui apprend à ses élèves à écrire les numéros jusqu’à 30 et un autre qui se focalise sur l’appropriation des décompositions des 5 premiers nombres, il n’y aura pas photo : seul le premier sera considéré comme un bon enseignant par les parents. Cela ne doit pas empêcher un enseignant qui pense qu’il est important de faire découvrir la suite des numéros au-delà de 10, et qui est capable de défendre ce point de vue, de conserver cette pratique pédagogique.
Pour autant, l’institution peut-elle se permettre que des progressivités très différentes soient adoptées ad vitam aeternam par les professeurs des écoles et que cette même différence se retrouve ad vitam aeternam chez les formateurs ? À l’évidence, non ! Si une progressivité est meilleure qu’une autre, c’est la meilleure qui, à terme, doit s’imposer. C’est la raison pour laquelle l’institution doit favoriser un débat approfondi et stimuler l’échange contradictoire en toute collégialité. C’est ainsi qu’elle engendrera une vraie responsabilisation et qu’elle créera une dynamique dans les choix faits, vers les meilleurs de ces choix. Il sera très important de veiller à la façon dont seront rédigés les futurs documents d’accompagnement des programmes. Il est en effet fondamental que, par leur forme, ils favorisent le débat concernant certaines questions didactiques qui doivent rester vives.
Écrire des documents d’accompagnement qui explicitent les débats autour des questions didactiques susceptibles de conduire à des progressivités différentes
Commençons par donner des exemples de telles questions didactiques : comment penser l’articulation entre le comptage et le calcul à l’école ? Quel usage des doigts pour les apprentissages numériques à l’école ? Quand et comment introduire les signes des opérations arithmétiques ? Faut-il à l’école primaire enseigner de « vrais nombres décimaux », ceux qui reposent sur un fractionnement successif de l’unité en dixièmes, centièmes, millièmes, dix-millièmes, etc. ou peut-on se contenter d’y enseigner l’utilisation de la virgule pour indiquer l’unité à l’intérieur d’un système de mesures : 312 cm, quand on prend pour unité le dm devient 31,2 dm, par exemple (l’idée de fractionnement est alors absente) ? Et la liste n’est évidemment pas close. C’est seulement un échantillon de questions didactiques qui doivent rester vives parce que, de toute évidence, des réponses mieux étayées que celles disponibles, sont à venir. La plupart de ces questions ont été débattues très tôt après la naissance de l’école de la République et tout laisse à penser qu’elles le seront encore pendant longtemps. Selon que l’on répond d’une façon ou d’une autre, ce ne sont pas les mêmes progressivités que l’on est conduit à adopter à l’intérieur de chaque cycle. Rédiger des documents qui explicitent les points forts et faibles des différents choix possibles est tout à fait envisageable.
De tels documents devraient évidemment être rédigés par des équipes mixtes : chercheurs en didactique, en psychologie, en sciences de l’éducation quand ils sont spécialistes des questions envisagées, enseignants de terrain. Souvent, ce sont les travaux en psychologie qui interrogent ceux en didactique, et réciproquement. Seule la mixité des équipes de rédaction peut conduire à un texte reflétant authentiquement les débats autour des questions abordées.
Les équipes de cycles qui auraient à gérer le choix d’une progressivité à partir de tels documents d’accompagnement, gèreraient une authentique liberté pédagogique, en ce qu’elle serait « entourée de toutes les garanties d’examen sérieux … / … dans les réunions générales des enseignants » (Ferdinand Buisson). De plus, il s’agirait vraisemblablement d’une avancée cruciale dans la lutte contre l’échec scolaire parce qu’on peut douter qu’un choix didactique relatif à ce type de questions, quel qu’il soit, puisse conduire à des pratiques efficaces sans que les professeurs des écoles se soient approprié les idées qui le fondent dans un contexte d’argumentation contradictoire. Toutes les recherches mettent en évidence ce que l’on appelle un « effet maître » qui renvoie au fait suivant : des enseignants peuvent avoir fait les mêmes choix didactiques et prodiguer des enseignements dont l’efficacité est très différente. En fait, l’efficacité d’un enseignant dépend beaucoup des régulations qu’il utilise face à des évènements de classe plus ou moins anticipés. Or ces régulations sont mieux adaptées lorsqu’il connaît les points forts et les points faibles du choix qui a été le sien.
De plus, si les futurs programmes et leurs documents d’accompagnement sont rédigés ainsi, les contenus de formation initiale et continue dans les ESPE ainsi que les épreuves pédagogiques du CRPE prendront progressivement cette même forme, ce qui aura pour conséquence de mettre ces institutions à l’abri d’un danger potentiellement mortifère : une subordination à des préconisations officielles qui entrave l’esprit critique. Précisons cette idée en prenant un exemple.
La principale association professionnelle des professeurs de mathématiques qui participent à la formation des professeurs des écoles, la COPIRELEM, a récemment proposé des « sujet 0 » pour le concours de recrutement 2014, celui de l’année à venir. Dans la partie didactique du sujet concernant l’école maternelle, les candidats doivent comparer deux tâches proposées à un élève de Grande Section et il est précisé que ces tâches doivent être résolues en « utilisant la comptine numérique ».
|
Tâche A : Un tas d’une vingtaine de jetons est devant lui. On lui demande combien il y a de jetons. Tâche B : L’élève reçoit une barquette ; le maître dit à l’élève d’aller chercher douze jetons dans la réserve et de les rapporter dans un panier. |
À aucun moment dans cette épreuve il n’est demandé au candidat de s’exprimer concernant la pertinence de telles tâches à ce niveau de la scolarité. Cela soulève évidemment un problème grave : le candidat bien informé des inconvénients résultant d’un enseignement du comptage-numérotage à l’école maternelle, est obligé de comparer deux tâches qu’il se refuserait l’une comme l’autre à proposer à des élèves de GS. Le jour où l’on est candidat à un concours est rarement celui où l’on prend le plus de risque et, donc, le candidat choisit généralement de taire ce qu’il pense vraiment. Il faut le dire clairement : l’épreuve didactique du CRPE, dans sa forme actuelle, ne conduit pas les candidats à s’interroger sur ce que l’on sait aujourd’hui concernant les principales questions didactiques, mais à apprendre les réponses attendues, celles qui leur donneront une chance de réussir le concours.
Si les programmes et leurs documents d’accompagnement sont rédigés comme nous le suggérons ici, ce type de sujets devrait disparaître rapidement. On imagine mal que l’on continue à demander aux candidats de comparer les deux tâches précédentes sans leur avoir préalablement demandé d’expliciter le choix de progressivité correspondant. Et si le concours prend cette forme, c’est toute la préparation au concours et donc les contenus de formation dans les ESPE qui s’en trouveront transformés, allant vers une authentique formation critique.
Concernant la formation initiale, examinons à titre d’exemple la forme que pourrait prendre une évaluation concernant la question qui nous a servi d’exemple ici : le statut didactique de la file des écritures chiffrées. Cette évaluation pourrait s’adresser à une doublette d’étudiants et se dérouler ainsi : l’un tire au hasard un choix didactique possible, la défense de l’usage d’une file numérotée par exemple, et il défendra ce choix contre l’autre étudiant qui, lui, argumentera en faveur de l’autre choix. Ce que fera chacun d’eux quand il aura une classe n’est pas l’enjeu de l’évaluation : il s’agit de vérifier que ce futur choix se fondera sur une bonne connaissance de l’alternative. C’est donc un état d’esprit différent qu’il convient de promouvoir : plutôt que de vouloir, sur tous les sujets, trancher concernant ce que sont les bonnes pratiques, il s’agit d’admettre que certaines questions didactiques restent vives et méritent débat. Et si, un jour, plus aucun enseignant de maternelle et de CP n’utilisait de file numérotée dans sa classe, comme c’était le cas il y a 50 ans, faudra-t-il continuer à organiser de tels débats ? Oui, bien sûr : c’est en maintenant vive la mémoire des débats passés qu’on crée les meilleures conditions pour que l’avenir ne soit pas un éternel recommencement.
Dans les IUFM, comme dans les ESPE, la formation en mathématiques des professeurs des écoles est, pour l’essentiel, assurée par des mathématiciens. Ainsi, même lorsqu’il s’agit d’aborder la construction du nombre chez les enfants de 2-3 ans, ce sont généralement des professeurs de mathématiques qui sont sollicités. Ayant été professeur de mathématiques en École Normale, puis en IUFM pendant 20 ans, avant de devenir enseignant-chercheur en psychologie, je peux assurer que ce n’est pas ma maîtrise de mathématiques (ancêtre du master) qui me sert le plus souvent lorsque j’aborde un grand nombre de questions, y compris l’enseignement des fractions au cycle 3. C’est ma formation en didactique des mathématiques et, très souvent, celle en psychologie. Cette dernière donne accès, via les articles de recherche, à des milliers de résultats expérimentaux relatifs à des tâches mathématiques décrites précisément et élaborées afin de tester telle ou telle conjecture résultant de telle ou telle théorie. Les principales caractéristiques des enfants participant à l’expérience ainsi que les résultats sont décrits tout aussi précisément. Il m’apparaît évident que l’idéal serait que les formateurs en ESPE disposent des deux formations afin d’avoir un accès direct aux articles de recherche. On n’en est pas là et un objectif beaucoup plus raisonnable serait qu’au sein des ESPE les personnes ayant ces formations différentes confrontent leurs points de vue et collaborent.
Si les documents d’accompagnement des programmes sont rédigés par des équipes mixtes, il apparaîtra presque évident que la meilleure façon de former les professeurs des écoles est de le faire également avec des équipes mixtes. Dans un numéro récent de la revue ANAE, Nicolas Gauvrit[ix] a publié un article intitulé : « Didactique des maths et psychologie : l’impossible débat ? ». D’un point scientifique, il est évident qu’un tel débat est nécessaire, son utilité pour une amélioration de la formation ne fait aucun doute. Le plus sûr moyen qu’il existe est évidemment que l’Éducation Nationale crée des institutions conduisant à de telles confrontations / collaborations dans la durée. Un groupe mixte chargé de la rédaction de documents d’accompagnement sous la forme que nous préconisons serait une telle institution et il devrait grandement contribuer à l’instauration d’un tel débat.
Signalons enfin qu’il existe également en français, et probablement dans d’autres disciplines, des questions didactiques débattues depuis bien longtemps et qu’il serait profitable d’aborder de cette manière dans les documents d’accompagnement des programmes concernant l’écrit à l’école. Ces questions sont notamment celles abordées récemment dans un texte d’André Ouzoulias, mis en ligne par le Café Pédagogique : comment enseigner le langage oral à l’école maternelle ? Comment favoriser la découverte du principe alphabétique ? Quels moyens utiliser pour faire écrire les élèves ? Comment articuler l’apprentissage de la lecture et celui de l’orthographe ? Là encore, la liste n’est évidemment pas close. Et là encore, on conçoit aisément que de tels documents d’accompagnement conduiraient, au sein des ESPE, à des collaborations entre professeurs de français et spécialistes de ces questions, qu’ils soient didacticiens, enseignants en psychologie, en sciences de l’éducation ou formateurs de terrain.
Concluons : la rédaction des futurs programmes et de leurs documents d’accompagnement crée l’opportunité d’aller vers ce que le ministre souhaitait : amorcer la refondation de l’école afin d’en améliorer les performances. Aujourd’hui, les tensions sont grandes entre les divers acteurs et les résultats de PISA risquent de les accroître, chacun cherchant à minimiser ses responsabilités. La forme proposée ici pour de futurs programmes et leurs documents d’accompagnement est susceptible au contraire de créer une dynamique permettant de canaliser de façon positive l’énergie des uns et des autres. Leur rédaction doit autoriser la présentation des différents courants de recherche préconisant des manières de faire différentes, dès lors que les objectifs en termes d’apprentissage sont respectés. Et parions que, dans leur forme au moins, si les programmes et leurs documents d’accompagnement sont rédigés de cette manière, ils vaudront pour très longtemps[x].
Rémi Brissiaud
Chercheur au Laboratoire Paragraphe, EA 349 (Université Paris 8)
Équipe « Compréhension, Raisonnement et Acquisition de Connaissances »
Membre du conseil scientifique de l’AGEEM
[i] Brissiaud, R. (2013) Apprendre à calculer à l’école – Les pièges à éviter en contexte francophone. Paris : Retz
[ii] Le Cam,M., Rocher, T. & Verlet, I. (2013) Forte augmentation des acquis des élèves à l’entrée au CP entre 1997 et 2007. Note 13.19 de la DEPP ; septembre 2013.
[iii] Mialaret, G. (1955) Pédagogie des débuts du calcul. Fernand Nathan, Paris (avec la collaboration de l’Unesco).
[v] Geary D.C., Fan L. & Bow-Thomas C.C. (1992). Numerical cognition: Loci of ability differences comparing children from China and the United States. Psychological Science, 3,180-185.
[vi] Hatano G. (1982) Learning to Add and Sustact : A Japonese Perspective. In T. Carpenter, J. Moser & T. Romberg (Eds) : Addition and Substraction : A Cognitive Perspective. Hillsdale, N.J. : Lawrence Erlbaum Associates
[vii] Brissiaud R. (1989) Comment les enfants apprennent à calculer – Au-delà de Piaget et de la théorie des ensembles. Paris : Retz
Brissiaud (2007) Premiers pas vers les maths – Les chemins de la réussite à l’école maternelle. Paris : Retz.
Fischer, J.-P. (1992) Les apprentissages numériques. Nancy, Presses Universitaires de Nancy
[ix] Gauvrit, N. (2012). Didactique des mathématiques et psychologie. L’impossible débat ? A.N.A.E., 120/121, 525-528.
[x] J’adresse mes plus vifs remerciements à André Ouzoulias et Philippe Champy pour avoir accepté de relire une première version de ce texte et m’avoir suggéré plusieurs améliorations.